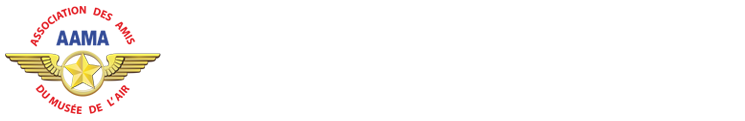C’est sous un chaud soleil digne de la douceur angevine que la dizaine de membres ayant répondu à l’appel de notre vice-président et organisateur de nos Visites exclusives Jean-François Louis, se retrouve sur le parking de l’Espace Air Passion à l’aéroport d’Angers-Marcé.
Nous sommes bientôt rejoints d’un pas alerte et décidé par Christian Ravel, qui exceptionnellement sera notre guide ce jour-là, fondateur du Groupement pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique (GPPA) en 1981, qui ouvrira en 1988 le Musée Régional de l’Air dans un hangar sur l’aérodrome d’Avrillé, très proche (trop) de la ville d’Angers.
Dix ans plus tard, encerclé par l’urbanisation, Avrillé sera abandonné et un nouvel aéroport, Angers-Loire, verra le jour à Marcé, à 30 km du centre d’Angers. La ville octroya un vaste bâtiment au musée qui prendra le nom Espace Air Passion en 2013.
Après de brèves présentations, nous nous dirigeons vers le restaurant de la plateforme, L’Envol. Durant ce bon repas avec vue sur les pistes, Christian Ravel nous narre son parcours atypique d’instituteur à moniteur de vol à voile, pilote professionnel (équivalent CPL) puis pilote de ligne chez UTA. Il partage avec nous quelques anecdotes truculentes sur sa vie professionnelle notamment ses vols en Afrique.
Il nous raconte ensuite les tous débuts de l’aventure du musée lorsqu’il décida de sauver du bûcher le planeur Nord 1300 n°209 sur lequel il avait effectué son premier vol solo vingt ans plus tôt. Bientôt un planeur Fauvel AV-36 rejoint également le sous-sol de Christian qui décide alors avec cinq autres plus fous que la moyenne de créer en septembre 1981 une association pour restaurer ces vieilles poubelles, le Groupement pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique (GPPA).
L’idée étant de préserver de vieilles machines de la destruction ou de la fuite vers l’étranger (notamment le Royaume-Uni).
Nous rejoignons le musée après un court trajet digestif, impatient de débuter la visite sous la houlette de notre guide d’exception.
L’Espace Air Passion s’ouvre sur un hall rond consacré aux frères Pierre et René Gasnier, pionniers de l’aéronautique angevine. Le biplan René Gasnier n°III suspendu au plafond, semble nous survoler nonchalamment.
Cet avion a un double intérêt pour le musée. Historique d’abord puisqu’il est l’auteur des premiers vols de plus lourd que l’air en Anjou en 1908. Technique ensuite puisque sa restauration a été confiée au tout jeune GPPA en 1983 par le maire d’Angers de l’époque Jean Monnier.
L’avion étant dans un état pitoyable. L’association va investir les anciens abattoirs de la ville pour établir son atelier et surtout recruter Paul Genest, qui pendant vingt ans sera le menuisier aéronautique de toutes les restaurations tout en transmettant son savoir aux bénévoles.
Le 18 décembre 1985 l’avion est remis à la ville d’Angers entièrement restauré (y compris son moteur Antoinette en état de fonctionnement) et sera même exposé quelques années dans la Grande Galerie du Musée de l’Air et de l’Espace. Cette restauration sera la pierre angulaire de la réflexion sur la conservation, la restauration et la présentation du patrimoine aéronautique menant à l’Espace Air Passion tel qu’il est aujourd’hui.
Christian nous présente ensuite une autre machine inédite, le Peyret-Mauboussin type 11. En 1930, Pierre Mauboussin, peu intéressé par la bijouterie familiale, se fit construire un atelier et s’associa avec Louis Peyret pour concevoir et construire des avions.
Cet exemplaire motorisé par un moteur Salmson de 40 cv et piloté par René Lefevre a rallié Paris à Saïgon et a parcouru plus de 35 000 km lors d’une boucle en Afrique passant par Madagascar.
Il porte fièrement une bande tricolore sur laquelle sont inscrits tous les pays traversés. A noter une belle maquette de Farman F-60 Goliath qui s’abrite sous cet appareil.
Notre guide nous mène vers un Broussard visitable. En effet cet avion est aménagé pour que petits et grands puissent monter à bord et s’installer aux commandes, tout comme la cellule de Fouga Magister quelques mètres plus loin.
Autour de l’avion se trouvent les ateliers, accessibles aux visiteurs. L’atelier mécanique, dont on aperçoit la richesse des équipements (machines-outils, banc d’essai d’équipements électriques ou hydrauliques), est malheureusement sans activité ce jour malgré les 245 cylindres présents dans le musée.
Nous migrons donc dans l’atelier menuiserie, lieu stratégique de l’activité de restauration du GPPA par lequel sont passées toutes les machines exceptionnelles exposées. Nous admirons le travail sur l’aile droite de l’avion Albert A-61 n°01 en cours de restauration. Cette aile était fort dégradée lors de la récupération de l’appareil. Les plans originaux n’étant pas disponibles, l’équipe a décidé de numériser l’aile gauche intacte pour refaire des plans et reconstruire l’aile droite avec les techniques et produits de l’époque. Nous découvrirons la cellule un peu plus tard.
Nous entrapercevons les ailes du Cessna UC-78 Bobcat soigneusement entreposées, attendant de retrouver son fuselage que nous découvrons dans l’atelier suivant.
Le fuselage du Bobcat, dont la restauration se poursuit depuis la précédente visite de l’AAMA (cf l’article de Dominique Abadie dans le Pégase n°167), occupe sur son bâti une grande partie de l’atelier entoilage.
Contre le mur opposé Christian nous montre les restes de l’Avia Xa n°2. Ce planeur est considéré comme le plus ancien planeur français et le seul existant de son type, donné au musée le 21 juillet 2021. C’est l’occasion de nous montrer le travail réalisé depuis cette date, synthétisé dans le Dossier historique et constat d’état. Ce document comprend le contexte historique, les origines du constructeur, les généralités sur le type de la machine, l’histoire connue de cette machine précise, les documents en possession (plans, photos…), recherche des teintes et décorations, étude des matériaux et techniques de construction et bien sûr les travaux envisagés. Ce sont 133 pages tout de même pour ce petit planeur.
Ainsi on apprend que le premier vol a été réalisé par Pierre Massenet, préfet du Rhône et les suivants par Michel Détroyat !
De la même façon la couleur bleue, encore visible de nos jours, est issue de la peinture pour charrette, largement disponible à cette époque.
Tous les aéronefs restaurés par le GPPA ont leur dossier de restauration qui permet de mieux connaître la machine mais aussi de solliciter partenaires et financeurs. Christian insiste sur la qualité du travail fourni par les bénévoles sous la direction du responsable d’atelier. Les maîtres mots sont la rigueur et la précision qui s’appuient sur une documentation technique la plus complète possible. La reconnaissance du travail bien fait passe aussi par le statut d’UEA (Unité d’Entretien Agréée) reconnu par la DGAC que détient le GPPA depuis trente ans.
A la sortie de l’atelier nous débouchons dans le grand hall. Le regard se perd vite dans la multitude d’avions, de planeurs et de modèles réduits qui s’exposent du sol au plafond.
Sur les environ deux cents machines dont dispose le musée, plus d’une quarantaine sont exposées par roulement au public, sans oublier la vingtaine en état de vol.
Notre hôte pointe du doigt un élégant planeur rouge suspendu au plafond. Il s’agit du DFS Weihe n°3, récupéré en 1982 des réserves du Musée de l’Air à Chartres après accord de son directeur le général Pierre Lissarrague. Il revolera en 1990 et en 1998 il deviendra le premier aéronef classé Monument Historique.
Suspendus dans son sillage, un Caudron C-800 Epervier et l’Arsenal Air 100 n°01.
Retour vers le sol où nous passons en revue d’autres planeurs : SG-38 allemand d’avant-guerre ; Avia 152, réplique en état de vol que pilota Christian Ravel en 2010.
Suivent Spalinger S-18 III (F-AZBI) ; München Mü-13 (F-CCRA) et Castel C-25S (F-CRBI).
Nous découvrons la cellule de l’avion Albert A-61 n°01 dans sa livrée originale noire, dont nous avions vu l’aile dans l’atelier menuiserie. Cet exemplaire unique a été conçu pour participer au Concours National des avions de tourisme à Orly en 1931.
Fait original, il avait marqué un temps d’arrêt à Angers lors de cette compétition dont il prendra la deuxième place.
A sa gauche se trouve le Nord 3400 Norbarbe n°78 de 1960 en cours de restauration également. Avion d’observation (mais aussi sanitaire ou photo) à capacité STOL propulsé par un moteur Potez 4D34 de 260 cv, il se caractérise par son vitrage formant un angle vers l’extérieur.
Son voisin est le Réné Leduc RL-21 n° 01. Cet avion de course effilé construit dans une salle à manger (et sans statoréacteur, comme ceux du Musée de l’Air du Bourget, car c’est un homonyme) a battu sept records du monde de vitesse dans la catégorie des avions de moins de 500kg et de moins de 1000kg. Ces records sont inscrits sur son fuselage sur fond de bande tricolore. Il est également classé Monument Historique.
Une autre rareté le Gérin V-6 E Varivol à envergure et surface portante variables. Cet appareil atypique a une histoire particulière représentative des turpitudes de la préservation d’aéronef. Conçu juste avant la Seconde Guerre mondiale, il fût caché et oublié dans une ferme pendant presque 60 ans.
Comme souvent, un banal coup de fil prévient le GPPA de la présence d’un avion sous un hangar agricole. Christian utilise alors une de ses formules récurrentes : Je prends Daniel, la voiture, la remorque et deux bouteilles de vin d’Anjou et on va voir !
La récupération se passe sans problème mais il n’y a pas de moteur et la documentation manque à propos de cet appareil unique. Après recherche, un moteur équivalent Renault 6 cylindres de 275 cv est trouvé et rapatrié d’Afrique. Une partie de la documentation technique sera donnée par l’ingénieur ayant fait les essais en soufflerie après une visite au musée. Par le même hasard, la fille du dessinateur de Jacques Gérin, ayant entendu parler de la restauration, offrira la liasse de plans originale ! Chance et persévérance.
Nous poursuivons en admirant le Caudron C.430, réplique de l’avion d’Hélène Boucher dans lequel elle disparut en 1934 ; le Morane-Saulnier 733 Alcyon ; le Colomban MC-15 Cri-Cri, l’hélicoptère Sud-Aviation SA 316B Alouette III, l’ornithoptère Riout 102-T Alérion et bien d’autres merveilles…
Un évènement étant prévu le week-end, les avions en état de vol sont repoussés sur le tarmac et nous ne verrons que de loin le Moynet 360-6 Jupiter, le Piper L-4H et le Morane-Saulnier 505 Criquet qui prenait son envol vers un meeting voisin.
Nous nous dirigeons à présent vers les réserves. Le vaste hall de 1500 m² est l’ancien bâtiment du Musée Régional de l’Air sur la plateforme d’Angers-Avrillé. Pour les passionnés que nous sommes les réserves s’apparentent à une caverne d’Ali Baba. Plusieurs dizaines d’aéronefs démontés, parfaitement rangés et répertoriés dans des cases spécifiques attendent leur restauration. Christian Ravel estime qu’il y en a pour trois siècles ! A raison d’une quinzaine d’année par avion et six à sept ans par planeur, c’est à peu près le temps nécessaire pour les 160 machines en attente.
Au gré de la déambulation, nous découvrons des avions uniques mais aussi des silhouettes familières et toutes ont une histoire que nous raconte avec beaucoup de plaisir le maître des lieux.
De la nacelle de dirigeable conçu par Roland de la Poype pour le Marineland ou l’unique Morane-Saulnier 572 n°01 récupéré chez un casseur où il servait d’enseigne (lire son histoire) ; le Croses B-EC-9 Para-cargo, évolution unique de 1976 du Pou-du-ciel pour emporter des parachutistes ; le Biplum, le plus léger ULM (95kg) conçu par Maurice Guerpont ; des planeurs sans queue Fauvel (AV-361 F-CRQX et AV-22) et le petit dernier, un Aermacchi MB 308 qui a trainé ses plumes à Madagascar.
Christian nous propose pour terminer cette journée de visiter les archives. Autre expression d’une caverne d’Ali Baba, nous découvrons un local de 200 m² abritant trois postes de numérisation (dossiers, documents et photos) et 2 000 mètres linéaires de documents techniques ; presse aéronautique depuis la fin du XIXe siècle ; livres ; BD ; documents historiques ; etc.
Il dispose également d’un fond photographique de plus de 250 000 clichés (y compris des plaques de verre) dont la moitié est numérisée. Le tout est consultable sur place.
Nous ne pouvons qu’être admiratifs de la passion débordante pour l’aviation et son histoire qui anime toujours Christian Ravel. Il a réussi à créer un musée vivant, animé par des bénévoles, accessible à tous, dont une section cadets du musée, qui assure la préservation du patrimoine aéronautique dans un esprit de transmission et avec toute la rigueur nécessaire.
Peut-être garde-t-il un regret de n’avoir pu concrétiser un partenariat durable avec le Musée de l’Air tel qu’il l’appelait de ses vœux dans son article paru dans le Pégase n°70 en 1993.
A noter qu’il a écrit un ouvrage remarquable sur les planeurs Avia.
Nous quittons à regret la bonhomie et la faconde de notre hôte, conscients de l’honneur et du privilège d’avoir partagé ce moment aéronautique avec Monsieur Ravel.
Frédéric Boderlique (AAMA)
Remerciements à nos membres Frédéric Boderlique, Jean-Pierre Cornand, Bertrand Dévé, Jean-François Louis, Charles Pigaillem et Domenico Rutigliano pour les photos.